La sécurité électrique représente un enjeu majeur dans nos installations modernes. Le schéma de mise à la terre constitue un système de protection fondamental, permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens face aux risques électriques.
Comprendre les bases de la mise à la terre
La mise à la terre forme un élément central dans la protection contre les accidents d'origine électrique. Cette installation technique répond à des normes strictes définies par le Code du travail et la norme NF C 15-100.
Le rôle fondamental du raccordement à la terre
La mise à la terre assure la protection des occupants en redirigeant le courant électrique vers le sol en cas de défaut d'isolation des équipements. Cette fonction protectrice intervient notamment lors des contacts indirects avec des masses conductrices accidentellement sous tension. Un système efficace nécessite une vérification régulière dans le cadre du diagnostic électrique obligatoire.
Les éléments constitutifs d'une installation de mise à la terre
Une installation de mise à la terre repose sur deux composants essentiels : la prise de terre et le conducteur de terre. La prise de terre peut être réalisée soit par des piquets verticaux enfoncés à minimum deux mètres de profondeur, soit par des conducteurs enfouis horizontalement. Le conducteur de terre établit la liaison entre la prise de terre et la borne principale, permettant les mesures de contrôle nécessaires.
Les différents schémas de liaison à la terre
La mise à la terre représente un élément fondamental dans une installation électrique. Elle assure la protection des personnes et des équipements en redirigeant le courant vers le sol en cas de défaut. Les schémas de liaison à la terre définissent la manière dont cette protection est organisée.
Les caractéristiques des régimes TT, TN et IT
Le régime TT établit une connexion directe des masses à la terre, avec une prise de terre distincte du neutre. Cette configuration est standard dans les installations domestiques françaises. Le régime TN relie les masses au neutre, créant ainsi un circuit unique. Il se divise en TN-C où neutre et protection sont combinés, et TN-S où ils sont séparés. Le régime IT isole le neutre de la terre ou le relie via une impédance élevée, une configuration utilisée dans les environnements nécessitant une continuité de service, notamment les hôpitaux.
Le choix du schéma adapté à votre installation
La sélection du schéma dépend des exigences spécifiques de l'installation. Le régime TT s'avère adapté aux installations résidentielles par sa simplicité et sa maintenance réduite. Le TN convient aux sites industriels avec un personnel qualifié. Le régime IT trouve sa place dans les installations où la continuité de service est indispensable. Cette décision repose sur l'analyse des risques, la nature des activités et le niveau de formation du personnel. Les normes NF C 15-100 guident ce choix en définissant les règles techniques à respecter pour chaque configuration.
La réalisation d'une mise à la terre conforme
La mise à la terre représente un élément fondamental dans les installations électriques. Elle offre une protection optimale des personnes et des biens en redirigeant le courant électrique vers le sol en cas de défaut d'isolation. Cette installation fait partie des points contrôlés lors du diagnostic électrique obligatoire.
Les étapes de l'installation d'une prise de terre
L'installation d'une prise de terre s'effectue selon deux méthodes principales. La première utilise des piquets verticaux, enfoncés à minimum deux mètres de profondeur. Les dimensions varient selon les matériaux : 25 mm pour un tube en acier galvanisé, 60 mm de côté pour un profilé en acier doux, ou 15 mm pour une barre en cuivre ou acier. La seconde méthode emploie des conducteurs enfouis horizontalement, soit en boucle à fond de fouille autour du bâtiment, soit en tranchées à un mètre de profondeur. Un regard de visite identifié doit être installé au niveau de la tête du piquet de terre.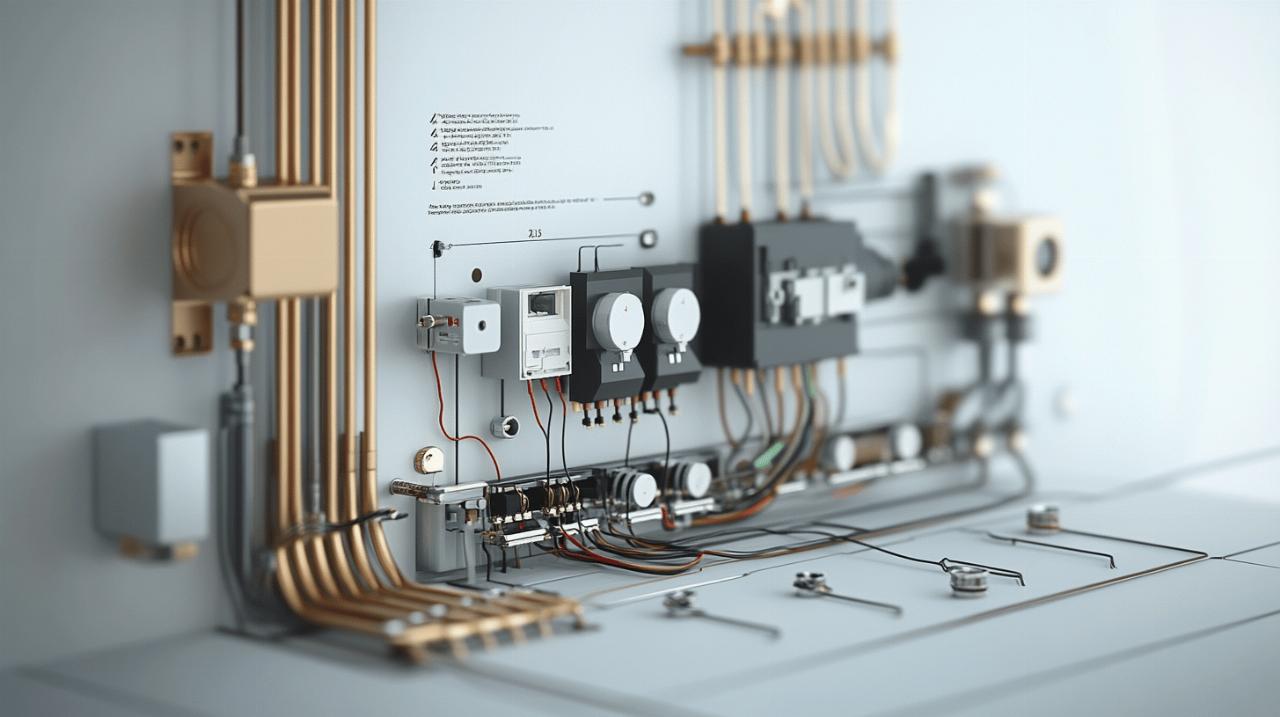
Les mesures et vérifications nécessaires
La sécurité électrique exige des vérifications régulières par des organismes accrédités, conformément au Code du travail. La résistance maximale de connexion des pièces métalliques au point de mise à la terre ne doit pas dépasser 10 Ohm. Les systèmes de mise à la terre se divisent en deux catégories : le système passif, nécessitant des contrôles fréquents, et le système actif avec surveillance permanente. Ce dernier utilise des indicateurs visuels, comme une LED verte, pour confirmer une connexion sécurisée. La borne principale de terre doit rester accessible pour permettre la mesure de la résistance de terre.
L'entretien et la maintenance du système de mise à la terre
La maintenance régulière du système de mise à la terre garantit la sécurité des installations électriques. Une surveillance attentive des composants et la réalisation de tests périodiques permettent d'assurer une protection optimale contre les risques électriques.
Les contrôles périodiques recommandés
Les vérifications régulières constituent une obligation pour maintenir la sécurité des installations. Un organisme accrédité doit effectuer des mesures de résistance de la prise terre selon les articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du Code du travail. La mesure s'effectue en déconnectant la borne principale, spécialement conçue pour cette opération. L'inspection visuelle du regard de visite et du conducteur de terre fait partie des points à examiner. Pour les systèmes passifs, la vérification de la continuité électrique doit confirmer une résistance inférieure à 1 ohm.
Les signes d'une installation défectueuse
Une installation de mise à la terre défaillante présente plusieurs indicateurs d'alerte. La corrosion des piquets de terre ou des conducteurs signale un besoin d'intervention. Les connexions desserrées au niveau de la borne principale représentent un danger pour la sécurité. Dans les systèmes actifs, l'absence d'indication lumineuse verte suggère une résistance supérieure à 10 ohms entre l'équipement et le point de mise à la terre. Les traces d'oxydation sur les composants métalliques, les raccordements abîmés ou les câbles dénudés nécessitent une action immédiate.
La formation et les certifications en sécurité électrique
La formation aux risques électriques représente un pilier fondamental dans la prévention des accidents. Elle s'inscrit dans le cadre réglementaire du Code du travail et garantit la sécurité des travailleurs lors des interventions sur les installations électriques.
Les niveaux d'habilitation et leurs spécificités
Les habilitations électriques définissent les compétences et autorisations d'intervention du personnel. La norme NF C 18-510 établit différents niveaux selon les tâches : B0 pour les travaux non-électriques, B1-B2 pour les interventions électriques, et BR pour les opérations spécifiques. Chaque niveau nécessite une formation adaptée et une évaluation des connaissances. L'employeur délivre le titre après validation des acquis et analyse des risques liés au poste. La formation aborde les classes de matériel électrique, les degrés de protection IP, et l'utilisation des équipements de protection individuelle comme les gants isolants ou les casques.
Les bonnes pratiques de consignation électrique
La consignation électrique suit un protocole précis pour garantir la sécurité lors des interventions. Elle comprend la séparation visible des sources d'énergie, la condamnation en position d'ouverture, la vérification d'absence de tension, et la mise à la terre. Les travailleurs doivent utiliser des équipements conformes aux normes, notamment des écrans faciaux NF EN 166 et des vêtements de protection adaptés. La signalisation des zones à risque et le respect strict des procédures sont indispensables. Les vérifications régulières par des organismes accrédités assurent le maintien du niveau de sécurité des installations.








